 Bref mais intense retour au pays pour Ang Lee avec Se, jie [Lust, Caution] - qu'on pourrait traduire en français par "Désir, prudence". Histoire d'espionnage placée au beau milieu de la Chine des années 30/ 40, ses promoteurs ont d'abord mis en avant ses scènes sexuelles très explicites qui lui ont d'ailleurs valu le classement NC-17 aux USA. Mais comme le thème de l'homosexualité pour le précédent film d'Ang Lee (Brokeback Mountain), le film ne se résume pas à ces dix minutes de galipettes (même si l'on avance le chiffre de 100 heures de tournages nécessaires pour ces quelques passages) Non, Se, jie raconte brillamment d'abord le parcours d'une bande de jeunes justes, étudiants idéalistes qui plongent dans une guerre qu'ils croient simple, propre, pour sombrer corps et âme dans la confrontation avec un homme de pouvoir trouble et sans pitié, mais toujours homme. L'amour, calque sublimé de leurs émotions, suit aussi cette épopée pour participer à ce magnifique naufrage. Une oeuvre noire sur l'ambigu et les illusions perdues qui marque une belle étape de plus pour Ang Lee.
Bref mais intense retour au pays pour Ang Lee avec Se, jie [Lust, Caution] - qu'on pourrait traduire en français par "Désir, prudence". Histoire d'espionnage placée au beau milieu de la Chine des années 30/ 40, ses promoteurs ont d'abord mis en avant ses scènes sexuelles très explicites qui lui ont d'ailleurs valu le classement NC-17 aux USA. Mais comme le thème de l'homosexualité pour le précédent film d'Ang Lee (Brokeback Mountain), le film ne se résume pas à ces dix minutes de galipettes (même si l'on avance le chiffre de 100 heures de tournages nécessaires pour ces quelques passages) Non, Se, jie raconte brillamment d'abord le parcours d'une bande de jeunes justes, étudiants idéalistes qui plongent dans une guerre qu'ils croient simple, propre, pour sombrer corps et âme dans la confrontation avec un homme de pouvoir trouble et sans pitié, mais toujours homme. L'amour, calque sublimé de leurs émotions, suit aussi cette épopée pour participer à ce magnifique naufrage. Une oeuvre noire sur l'ambigu et les illusions perdues qui marque une belle étape de plus pour Ang Lee.
Chine, fin des années 40. Alors que les troupes japonaises envahissent peu à peu le pays, certains collaborent avec l'envahisseur, d'autres résistent contre l'occupation.
Wong Chia Chi (Wei Tang), jeune étudiante, entraînée par le pur et séduisant Kuang Yu Min (Leehom Wang), est elle définitivement du côté des derniers, tout comme leur troupe de théâtre.
Avec leurs camarades, ils décident après un spectacle de soutien aux troupes chinoises de passer à l'action et de supprimer Mr. Yee (Tony Leung, toujours aussi excellent), l'un des principaux agents de Wang Jingwei, dirigeant alors le gouvermenent fantoche collaborant avec les japonais.

La troupe se rend donc, sans autre moyen que les leurs à Hong-Kong, où Mr. Yee est retranché dans une villa fortement défendue, et entreprennent de pénétrer ses défenses.
Wong Chia Chi seule semble en mesure de le faire et tente de le séduire sous l'identité de Mrs. Mak, femme de négociant.
Vierge mais confrontée à la possibilité de devoir coucher avec Yee, elle se voit forcée d'acquérir de l'expérience avec l'un de ses camarades, Liang Junsheng (Lawrence Ko), malgré l'attirance réciproque qu'elle ressent pour Kuang Yu Min. Un premier sacrifice pour la cause, une première désillusion pour les idéaux romantiques de tous qui en augure d'autres plus sombres, plus terribles...
La descente aux enfers de Wong Chia Chi est donc le fil suivi par Ang Lee pour décrire cet apprentissage de la vie de la bande de jeunes. Wei Tang, qui incarne avec talent le personnage, joue parfaitement l'adolescente naïve qui passe de sacrifice en renoncement, espionne, actrice, amante, femme fatale à la poursuite d'un objectif dont elle n'est finalement plus certaine qu'il en vaille la peine.

Face à elle, Tony Leung (Hero, Internal Affairs, In the Mood for Love, Une Balle dans la Tête...il aura décidément tourné avec tous les plus grands), l'un des meilleurs acteurs chinois de sa génération, campe parfaitement un personnage cynique et froid qui s'ouvre imperceptiblement, malgré lui, à une passion frénétique. Le jeu, tout en retenue et en équilibre est bien maîtrisé jusque dans les fameuses scènes chaudes, qui rajoutent incontestablement une vraie dimension au film, rendant palpable la fusion progressive et inexorable entre Wong Chia Chi et Mr. Yee.
Fort heureusement, les quelques 2h15 de film restantes regorgent également de scènes marquantes ciselées où chaque acteur à la chance de pouvoir fournir une véritable consistance à son personnage.

Scène de jeu de Mah-Jong avec dialogues à double signification, visite du quartier japonais de Shangaï, explication des états d'âme de Wong Chia Chi vis à vis du responsable de sa cellule... même si Ang Lee fait parfois un peu traîner l'action dramatique au profit de la description des lieux, la finesse du réalisateur fait merveille.
Rien n'est gratuit, que ce soit dans les décors, les personnages - de la star au figurant -, les mimiques, les dialogues.
Le spectateur, transporté dans le Hong-Kong et le Shangaï de la seconde guerre mondiale, est bien avec cette équipe de jeunes activistes en herbe en route pour leur destin. Il partagera avec eux le rêve comme l'amertume, jusqu'au bout.
Merci Ang Lee!
Note: 15,5/20





 Pas facile de faire du neuf dans le "slasher", ce type de film d'horreur où une petite troupe d'adolescents est décimée par un mystérieux tueur sanguinaire. Depuis Dark Christmas (1974), beaucoup de coins, de recoins, d'allées et de contre-allées avaient été explorés, et faute de véritable nouveauté (Blairwitch Project en était une des dernières - 12 ans déjà), les réalisateurs n'hésitaient plus depuis belle lurette à verser dans le pastiche de qualité variable (ainsi la série des Scream) Beaucoup des afficionados du genre en sont donc maintenant réduits avec force moyens à tourner des remakes des classiques - Texas Chainsaw Massacre par exemple, mais beaucoup d'autres sont encore dans les tuyaux - éventuellement gonflés (pitoyable remise à neuf) au 3D. Simple mais efficace, Tucker & Dale vs. Evil, premier long métrage d'Eli Craig, réussit, lui, sur une idée qui sera reprise et développée tout le long du film, et en collant à la formule magique du slasher, à distraire et à faire du neuf avec ce (pas si) vieux. L'idée en question? Une inversion des rôles basée sur les constructions mentales récurrentes au genre. En (plus) clair, les méchants ne sont pas ceux qu'on croît.
Pas facile de faire du neuf dans le "slasher", ce type de film d'horreur où une petite troupe d'adolescents est décimée par un mystérieux tueur sanguinaire. Depuis Dark Christmas (1974), beaucoup de coins, de recoins, d'allées et de contre-allées avaient été explorés, et faute de véritable nouveauté (Blairwitch Project en était une des dernières - 12 ans déjà), les réalisateurs n'hésitaient plus depuis belle lurette à verser dans le pastiche de qualité variable (ainsi la série des Scream) Beaucoup des afficionados du genre en sont donc maintenant réduits avec force moyens à tourner des remakes des classiques - Texas Chainsaw Massacre par exemple, mais beaucoup d'autres sont encore dans les tuyaux - éventuellement gonflés (pitoyable remise à neuf) au 3D. Simple mais efficace, Tucker & Dale vs. Evil, premier long métrage d'Eli Craig, réussit, lui, sur une idée qui sera reprise et développée tout le long du film, et en collant à la formule magique du slasher, à distraire et à faire du neuf avec ce (pas si) vieux. L'idée en question? Une inversion des rôles basée sur les constructions mentales récurrentes au genre. En (plus) clair, les méchants ne sont pas ceux qu'on croît. 

 Les ficelles sont parfois énormes, les gags amorcés avec tambour et trompette, mais le plaisir n'est plus alors dans la surprise, mais dans l'expectative: oseront-ils, et quand? Et oui, ils osent, et pas plus tard que maintenant.
Les ficelles sont parfois énormes, les gags amorcés avec tambour et trompette, mais le plaisir n'est plus alors dans la surprise, mais dans l'expectative: oseront-ils, et quand? Et oui, ils osent, et pas plus tard que maintenant. 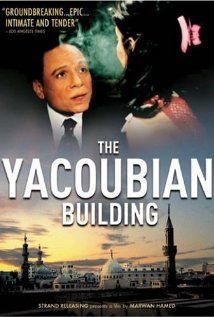 Qui n'a pas entendu parler de L'immeuble Yacoubian, immense succès d'édition de ces dix dernières années dans le monde arabe, et dans le monde tout court. Premier roman d'Alaa al-Aswani repris dans ce premier film d'Ahmed Marwan, il décrit sans fard pendant plus de deux heures et demi à travers l'histoire des habitants d'un vieil immeuble somptueux du Caire la société égyptienne et ses troubles actuels. Corruption, islamisme, vision de l'homosexualité, harcèlement, violence: les problèmes se répondent les uns aux autres pour construire une toile infernale dans laquelle le malheur et les malfaisants se répondent et prospèrent en toute impunité. Un véritable pourrissement de la société et de ses individus dans un cadre pourtant idyllique, les espoirs impitoyablement battus en brèche par un "système" dévoyé et corrompu: le tableau peint par Omaret Yakobean est impitoyable.
Qui n'a pas entendu parler de L'immeuble Yacoubian, immense succès d'édition de ces dix dernières années dans le monde arabe, et dans le monde tout court. Premier roman d'Alaa al-Aswani repris dans ce premier film d'Ahmed Marwan, il décrit sans fard pendant plus de deux heures et demi à travers l'histoire des habitants d'un vieil immeuble somptueux du Caire la société égyptienne et ses troubles actuels. Corruption, islamisme, vision de l'homosexualité, harcèlement, violence: les problèmes se répondent les uns aux autres pour construire une toile infernale dans laquelle le malheur et les malfaisants se répondent et prospèrent en toute impunité. Un véritable pourrissement de la société et de ses individus dans un cadre pourtant idyllique, les espoirs impitoyablement battus en brèche par un "système" dévoyé et corrompu: le tableau peint par Omaret Yakobean est impitoyable. 




 Et pourtant, de cet indescriptible méli-mélo surgit, implacable, une cohérence portée par la puissance des symboles, la force des détails qui surgissent et resurgiront plus tard sous une autre forme.
Et pourtant, de cet indescriptible méli-mélo surgit, implacable, une cohérence portée par la puissance des symboles, la force des détails qui surgissent et resurgiront plus tard sous une autre forme. 
 La série historique phare de Showtime (
La série historique phare de Showtime (

 On vogue donc avec The Borgias dans le faste, les décors rutilants, les lents travelings qui rentabiliseront la dépense, et sur les liens père-mère-frères-soeurs -pièces rapportées Borgias au détriment du reste. De tout le reste.
On vogue donc avec The Borgias dans le faste, les décors rutilants, les lents travelings qui rentabiliseront la dépense, et sur les liens père-mère-frères-soeurs -pièces rapportées Borgias au détriment du reste. De tout le reste. 
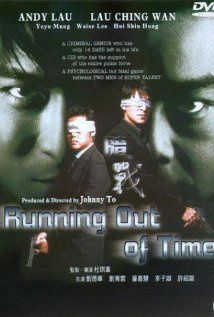





 Bien entendu, sur le sujet Erica Cox est agréable à voir et à revoir, mais ne fait pas un film à elle toute seule.
Bien entendu, sur le sujet Erica Cox est agréable à voir et à revoir, mais ne fait pas un film à elle toute seule.  Nagisa Ôshima, c'est souvent des sujets choquants tirés de la réalité ou de l'histoire japonaise et abordés sous un angle singulier. On se souvient de Ai no korîda [L'empire des sens], Merry Christmas Mr. Lawrence [Furyo], Max mon amour ou encore sa dernière oeuvre, Gohatto [Tabou]. Hanuchû no tôrima, ou L'obsédé en plein jour ne déroge pas à cette habitude. Tiré d'une histoire vraie du Japon des années 50, il expose le parcours d'un violeur en série, non pas à travers la relation des faits bruts comme le faisait le remarquable
Nagisa Ôshima, c'est souvent des sujets choquants tirés de la réalité ou de l'histoire japonaise et abordés sous un angle singulier. On se souvient de Ai no korîda [L'empire des sens], Merry Christmas Mr. Lawrence [Furyo], Max mon amour ou encore sa dernière oeuvre, Gohatto [Tabou]. Hanuchû no tôrima, ou L'obsédé en plein jour ne déroge pas à cette habitude. Tiré d'une histoire vraie du Japon des années 50, il expose le parcours d'un violeur en série, non pas à travers la relation des faits bruts comme le faisait le remarquable 

 Saviez-vous comment les premiers mutants se sont découverts? La manière dont Magnéto et le professeur Xavier avaient fait connaissance? Et plus important, que ce dernier n'avait pas toujours été chauve? Si ces questions troublaient votre sommeil, ou que vous avez plus simplement soif de nouvelles aventures de super-héros, alors X-Men: First Class est pour vous. L'écurie Marvel a en effet décidé de répondre à toutes ces interrogations et plus encore à travers un tout nouvel épisode de la saga des X-Men, "prequel" qui explique le pourquoi et le comment de l'équipe de mutants et de ses nemesis, sur fond d'années 60 et de crise des missiles à Cuba - car oui oui, les X-men furent étroitement mêlés à cette crise, qui constitue le décor historique du film. Aux manettes, un habitué des super-héros: Matthew Vaughn lui-même, le réalisateur de l'exceptionnel
Saviez-vous comment les premiers mutants se sont découverts? La manière dont Magnéto et le professeur Xavier avaient fait connaissance? Et plus important, que ce dernier n'avait pas toujours été chauve? Si ces questions troublaient votre sommeil, ou que vous avez plus simplement soif de nouvelles aventures de super-héros, alors X-Men: First Class est pour vous. L'écurie Marvel a en effet décidé de répondre à toutes ces interrogations et plus encore à travers un tout nouvel épisode de la saga des X-Men, "prequel" qui explique le pourquoi et le comment de l'équipe de mutants et de ses nemesis, sur fond d'années 60 et de crise des missiles à Cuba - car oui oui, les X-men furent étroitement mêlés à cette crise, qui constitue le décor historique du film. Aux manettes, un habitué des super-héros: Matthew Vaughn lui-même, le réalisateur de l'exceptionnel 

 Les fans seront aussi ravis de recevoir tant d'explications sur le passé de leurs héros favoris. La construction des personnages dans les épisodes précédents imposaient de leur fournir des particularités - souvent créées ou utilisées pour introduire une attente - qui trouvent leurs explication dans cet opus (pourquoi Xavier est-il en fauteuil roulant par exemple)
Les fans seront aussi ravis de recevoir tant d'explications sur le passé de leurs héros favoris. La construction des personnages dans les épisodes précédents imposaient de leur fournir des particularités - souvent créées ou utilisées pour introduire une attente - qui trouvent leurs explication dans cet opus (pourquoi Xavier est-il en fauteuil roulant par exemple)  Autre bémol pour un film du genre sorti en 2011, l'absence de 3D. La question de savoir pourquoi diable certains long-métrages ont été tourné en relief se pose souvent, mais ici c'est l'inverse. Le déversement d'effets spéciaux, qui fait aussi l'intérêt des films estampillés Marvel imposait la 3D à certaines des scènes de First Class, mais celle-ci passe à la trappe. Dommage.
Autre bémol pour un film du genre sorti en 2011, l'absence de 3D. La question de savoir pourquoi diable certains long-métrages ont été tourné en relief se pose souvent, mais ici c'est l'inverse. Le déversement d'effets spéciaux, qui fait aussi l'intérêt des films estampillés Marvel imposait la 3D à certaines des scènes de First Class, mais celle-ci passe à la trappe. Dommage. 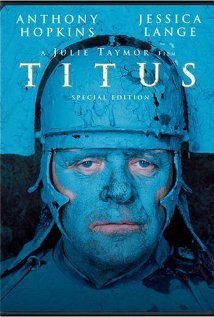 Lamentable histoire que celle de Titus Andronicus. C'est en tous cas le titre original de la première tragédie de Shakespeare (The Lamentable Tragedy of Titus Andronicus), plus reprise aujourd'hui sous l'appellation Titus Andronicus, et dans ce film de Julie Taymor - apparemment shakespearienne assidue* -, Titus tout court. Réputée pour être la plus sanglante du dramaturge, cette pièce a souvent donné lieu à des débordements dans la violence et l'hémoglobine, mêlant complots, assassinats, viol, mutilations, anthropophagie et meurtre d'enfant. Un monument classique porté à l'écran sur 162 minutes et avec beaucoup de moyens: décors somptueux, stars hollywoodiennes (Anthony Hopkins et Jessica Lange), effets spéciaux... pour une vision qui se veut actualisée de la triste histoire de ce général romain.
Lamentable histoire que celle de Titus Andronicus. C'est en tous cas le titre original de la première tragédie de Shakespeare (The Lamentable Tragedy of Titus Andronicus), plus reprise aujourd'hui sous l'appellation Titus Andronicus, et dans ce film de Julie Taymor - apparemment shakespearienne assidue* -, Titus tout court. Réputée pour être la plus sanglante du dramaturge, cette pièce a souvent donné lieu à des débordements dans la violence et l'hémoglobine, mêlant complots, assassinats, viol, mutilations, anthropophagie et meurtre d'enfant. Un monument classique porté à l'écran sur 162 minutes et avec beaucoup de moyens: décors somptueux, stars hollywoodiennes (Anthony Hopkins et Jessica Lange), effets spéciaux... pour une vision qui se veut actualisée de la triste histoire de ce général romain. 

