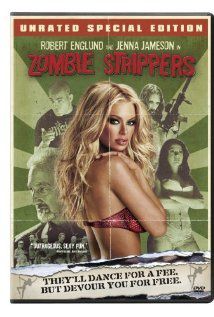 Zombie Strippers! ... Zombie strippers??? Le zombie, créature hideuse et anti-glamour, serait-il un adepte du déshabillage, voire du strip-tease? Et quel en serait l'intérêt? Jay Lee décide de nous faire profiter de ses connaissances - ou de ses intuitions - en la matière avec un film clairement axé sur la parodie et la série B au goût d'un Rodriguez ou d'un Tarantino qui disposerait de beaucoup, beaucoup moins de moyens que les réalisateurs/ producteurs de Machete et de From Dusk till Dawn [Une Nuit en Enfer] Manque d'argent n'implique pas forcément défaut d'imagination, et les surprises de tous ordres abondent dans ce qu'on aurait mauvaise foi à appeler un chef d'oeuvre, mais qui ne laissera à coup sûr personne - fans y compris - insensible.
Zombie Strippers! ... Zombie strippers??? Le zombie, créature hideuse et anti-glamour, serait-il un adepte du déshabillage, voire du strip-tease? Et quel en serait l'intérêt? Jay Lee décide de nous faire profiter de ses connaissances - ou de ses intuitions - en la matière avec un film clairement axé sur la parodie et la série B au goût d'un Rodriguez ou d'un Tarantino qui disposerait de beaucoup, beaucoup moins de moyens que les réalisateurs/ producteurs de Machete et de From Dusk till Dawn [Une Nuit en Enfer] Manque d'argent n'implique pas forcément défaut d'imagination, et les surprises de tous ordres abondent dans ce qu'on aurait mauvaise foi à appeler un chef d'oeuvre, mais qui ne laissera à coup sûr personne - fans y compris - insensible.
Dans un futur proche - et maintenant alternatif, Bush en étant à son quatrième mandat -, une expérience viralo-chimique qui tourne mal et voilà une petite épidémie de zombie lancée.
Heureusement, l'escouade "Z" des marines est appelée pour juguler la menace et agit avec toute la délicatesse requise, massacrant à tour de bras les mort-vivants en vadrouille.
Las, un de ses membres, Byrdflough (Zak Kilberg), mordu in extremis, préfère la fuite à l'exécution sommaire par ses camarades et se réfugie dans un strip-club clandestin - oui, le politiquement correct a encore fait des progrès sous Bush 3, les lieux de perdition sont maintenant interdits - et voisin.
Dans cet antre de débauche se déshabillent lascivement pour le plus grand bonheur des mâles du coin quelques beautés de profils variés et intéressants: la pin-up intello blonde, Kat (Jenna Jameson, ancienne reine du porno "pour de vrai"), sa rivale brune, sa copine rousse (Penny Drake), Lilith la gothique (Roxy Saint), et quelques autres dont Jessy, la petite dernière fraîchement débarquée de sa cambrousse (Jennifer Holland)

Ian, le patron du bouge (Robert Englund en personne - oui oui, notre Freddy préféré, aussi connu pour son rôle de lézard végétarien de V quand il n'est pas maquillé), est bien embêté quand Byrdflough égorge Kat en plein numéro.
Fort heureusement pour son business, elle revient bientôt à la non-vie, et les femmes mettant moins de temps à se décanter quand elles se transforment en zombie - l'information a été subtilement glissée dans les premières minutes du film -, Kat acquiert même des capacités sportives qui la transforment en déesse du pole et du lap dancing.

De quoi en rendre ses petites camarades malades de jalousie, non? L'histoire ne fait bien sûr que commencer, car la zombie-star est partageuse...
Si le scénario a été travaillé, c'est dans les détails, pas dans l'intrigue général, ici un prétexte.
Jay Lee a en effet choisi de se poser dans la parodie, et s'y vautre à coeur joie: petites phrases allusives au contexte politique américain voire international, personnages ultra-stéréotypés cultivant la bêtise, le cynisme, la naïveté à qui mieux-mieux et sortant des réparties de haute volée intellectuelle à brûle-pourpoint.
Les effets spéciaux gore et zombie-style sont également bien travaillés, surtout dans les tenues des danseuses zombies. Têtes qui explosent ou sont fendues en deux, membres arrachés, musique hard et assumée: on reste dans le classique du genre.

Les actrices ont été choisies pour leur jeu (bien sûr), mais également pour leurs mensurations. Les femmes semblant avoir pour défense naturelle de se débarrasser de leurs tee-shirts et pantalon en situation de danger - c'est en tous cas un des enseignements du film -, les séquences sexy ne décevront donc pas non plus.
Pour le reste, budget oblige, certains traitements très série B pourrissent quand même l'ambiance, le plus imposant gisant dans la composition très légère du commando "Z", du casting aux uniformes et à l'armement, en passant par les séquences de mitraillages qui combinent avec plus ou moins de bonheur lâchers de douilles, éclairs numériques et gigotages d'armes. De ce côté pas grand-chose à sauver, et c'est bien dommage. Pour trouver pire, se reporter néanmoins aux oeuvres de Noboru Iguchi (Kataude mashin gâru [The Machine Girl] par exemple)
Du coup beaucoup de défauts qui passeraient à l'as en temps "normal" ressortent dans le montage, les éclairages, l'inégalité de jeu entre certains acteurs. Dans certains cas on ne sait plus très bien si on patauge dans la caricature ou dans la mauvaise interprétation, mais on patauge, indéniablement.
Sans la prestation d'Englund, qui tient une bonne partie du film et navigue avec aisance dans les registres comique comme tragique, le naufrage était assuré, et le dévidage de cette surprenante association strip-tease et zombies, Eros et Thanatos "grotesquifiés" sombrait dans les ténèbres et l'irrémédiable médiocrité. Avec tout le fun et le mauvais goût jouissifs qui l'accompagnent.
Ouf, on est sauvés!
Note: 09,5/20
 Un homme raconte une histoire dans un salon cossu. Une histoire sordide. L'histoire fait son petit effet sur l'assemblée et se termine.
Un homme raconte une histoire dans un salon cossu. Une histoire sordide. L'histoire fait son petit effet sur l'assemblée et se termine.  L'interprétation de Lonsdale est brillante, captivante, presque hypnotique, et pourtant le témoignage, la vérité brute, ce n'est pas lui, c'est l'autre.
L'interprétation de Lonsdale est brillante, captivante, presque hypnotique, et pourtant le témoignage, la vérité brute, ce n'est pas lui, c'est l'autre. 




 En cette fin des années 60 souffle un vent de révolution dans la jeunesse européenne. La contestation monte, multiforme, à la recherche de nouvelles formes d'expression, touchant toutes les formes d'art. La Pacifista (La pacifiste) s'inscrit dans cette mouvance par son thème comme par son style, radicalement différents de la norme de l'époque, et qui n'ont, il faut l'avouer, pas marqué assez pour ne laisser aujourd'hui qu'un parfum de nostalgie de ces années où, après tout, "ça" n'allait pas si mal. Aux manettes, un réalisateur controversé pour ses positions politiques et considéré par certains comme un génie du cinéma, le hongrois Miklos Jancso, alors émigré en Italie.
En cette fin des années 60 souffle un vent de révolution dans la jeunesse européenne. La contestation monte, multiforme, à la recherche de nouvelles formes d'expression, touchant toutes les formes d'art. La Pacifista (La pacifiste) s'inscrit dans cette mouvance par son thème comme par son style, radicalement différents de la norme de l'époque, et qui n'ont, il faut l'avouer, pas marqué assez pour ne laisser aujourd'hui qu'un parfum de nostalgie de ces années où, après tout, "ça" n'allait pas si mal. Aux manettes, un réalisateur controversé pour ses positions politiques et considéré par certains comme un génie du cinéma, le hongrois Miklos Jancso, alors émigré en Italie. 

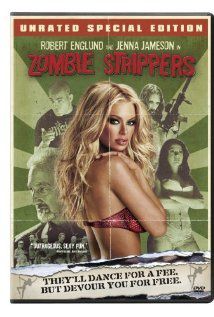 Zombie Strippers! ... Zombie strippers??? Le zombie, créature hideuse et anti-glamour, serait-il un adepte du déshabillage, voire du strip-tease? Et quel en serait l'intérêt? Jay Lee décide de nous faire profiter de ses connaissances - ou de ses intuitions - en la matière avec un film clairement axé sur la parodie et la série B au goût d'un Rodriguez ou d'un Tarantino qui disposerait de beaucoup, beaucoup moins de moyens que les réalisateurs/ producteurs de
Zombie Strippers! ... Zombie strippers??? Le zombie, créature hideuse et anti-glamour, serait-il un adepte du déshabillage, voire du strip-tease? Et quel en serait l'intérêt? Jay Lee décide de nous faire profiter de ses connaissances - ou de ses intuitions - en la matière avec un film clairement axé sur la parodie et la série B au goût d'un Rodriguez ou d'un Tarantino qui disposerait de beaucoup, beaucoup moins de moyens que les réalisateurs/ producteurs de 


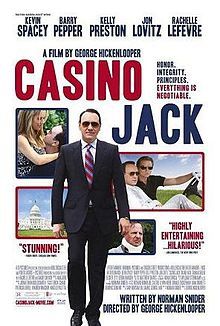 2006: scandale à Washington. Jack Abramoff, un des lobbyistes les plus actifs du petit monde de la politique américaine, est impliqué dans un nombre croissant d'affaires louches qui éclatent au grand jour: escroquerie de tribus indiennes, embrouilles autour de casinos flottants, assassinat lié à la mafia. Les magouilles de tous ordres sortent au grand jour les unes après les autres, éclaboussant politiciens et hommes de pouvoir liés au parti républicain. Une histoire de choix donc pour l'industrie du film, qui sortira en 2010 deux long-métrages sur le sujet: un documentaire, Casino Jack and the United States of Money (d'Alex Gibney) et ce Casino Jack, de George Hickenlooper, avec un rôle de choix pour Kevin Spacey, celui d'Abramoff en personne. Le film se veut re-création de cette période bien agitée de la vie de cet homme d'influence aux mains sales sur un mode combinant humour satyrique et mise en perspective morale du monde politique de la colline du Capitole.
2006: scandale à Washington. Jack Abramoff, un des lobbyistes les plus actifs du petit monde de la politique américaine, est impliqué dans un nombre croissant d'affaires louches qui éclatent au grand jour: escroquerie de tribus indiennes, embrouilles autour de casinos flottants, assassinat lié à la mafia. Les magouilles de tous ordres sortent au grand jour les unes après les autres, éclaboussant politiciens et hommes de pouvoir liés au parti républicain. Une histoire de choix donc pour l'industrie du film, qui sortira en 2010 deux long-métrages sur le sujet: un documentaire, Casino Jack and the United States of Money (d'Alex Gibney) et ce Casino Jack, de George Hickenlooper, avec un rôle de choix pour Kevin Spacey, celui d'Abramoff en personne. Le film se veut re-création de cette période bien agitée de la vie de cet homme d'influence aux mains sales sur un mode combinant humour satyrique et mise en perspective morale du monde politique de la colline du Capitole. 


 On en finit même parfois par ne plus distinguer ce qui est légal de ce qui ne l'est pas.
On en finit même parfois par ne plus distinguer ce qui est légal de ce qui ne l'est pas.  Il-gon Song est devenu l'un des réalisateurs coréens les plus renommés à l'étranger grâce à une voie plutôt originale de nos jours, celle du court-métrage. Il est ainsi le premier coréen à avoir obtenu un prix à Cannes pour Sopoong [Picnic] en 1999. Loin du style "sex and violence" maintenant bien connu chez nous des enfants terribles du cinéma coréen (Chan-Wook Park, Joon-ho Bong & Co), ses premières réalisations visent moins le marché commercial que celui du cinéma artistique en abordant essentiellement des thèmes personnels et sentimentaux. Son troisième long métrage, Git, ou Feathers in the Wind (en français: Plumes dans le vent), s'inscrit dans cette lignée de films asiatiques profondément romantiques où la première préoccupation n'est pas l'action, mais la rencontre et l'intensité des émotions - souvent cachées - des personnages.
Il-gon Song est devenu l'un des réalisateurs coréens les plus renommés à l'étranger grâce à une voie plutôt originale de nos jours, celle du court-métrage. Il est ainsi le premier coréen à avoir obtenu un prix à Cannes pour Sopoong [Picnic] en 1999. Loin du style "sex and violence" maintenant bien connu chez nous des enfants terribles du cinéma coréen (Chan-Wook Park, Joon-ho Bong & Co), ses premières réalisations visent moins le marché commercial que celui du cinéma artistique en abordant essentiellement des thèmes personnels et sentimentaux. Son troisième long métrage, Git, ou Feathers in the Wind (en français: Plumes dans le vent), s'inscrit dans cette lignée de films asiatiques profondément romantiques où la première préoccupation n'est pas l'action, mais la rencontre et l'intensité des émotions - souvent cachées - des personnages. 





 En ce qui concerne le rythme du film, on pense évidemment au scénario, original pour l'époque, de Groundhog Day [Un jour sans fin]*, dont les ressorts sont extrêmement similaires. La même séquence déclinée avec des variations de plus en plus conséquentes y offrait des opportunités faciles de comique (de répétition) et retendait à chaque fois le suspense. Les effets ici sont les mêmes, et fonctionnent aussi bien côté comédie que côté action.
En ce qui concerne le rythme du film, on pense évidemment au scénario, original pour l'époque, de Groundhog Day [Un jour sans fin]*, dont les ressorts sont extrêmement similaires. La même séquence déclinée avec des variations de plus en plus conséquentes y offrait des opportunités faciles de comique (de répétition) et retendait à chaque fois le suspense. Les effets ici sont les mêmes, et fonctionnent aussi bien côté comédie que côté action.  Un Hitchcock habilement réjuvéné grâce à de petites touches sur différents personnages. La plus marquante se trouve dans le profil psychologique du docteur Rutledge (Jeffrey Wright, le Felix Leiter de Casino Royal et de Quantum of Solace), le responsable du projet de recherche pour lequel Colter et Goodwin travaillent. Un modèle atypique et très intéressant de méchant égocentrique, frustré et avide de pouvoir, en apparence au service de l'état et donc (?) du bien, mais en fait capable du cynisme le plus implacable quand ça arrange son avancement.
Un Hitchcock habilement réjuvéné grâce à de petites touches sur différents personnages. La plus marquante se trouve dans le profil psychologique du docteur Rutledge (Jeffrey Wright, le Felix Leiter de Casino Royal et de Quantum of Solace), le responsable du projet de recherche pour lequel Colter et Goodwin travaillent. Un modèle atypique et très intéressant de méchant égocentrique, frustré et avide de pouvoir, en apparence au service de l'état et donc (?) du bien, mais en fait capable du cynisme le plus implacable quand ça arrange son avancement. 


 Kevin Macdonald est écossais et fier de l'être. Il l'avait déjà revendiqué en filigrane dans le très bon
Kevin Macdonald est écossais et fier de l'être. Il l'avait déjà revendiqué en filigrane dans le très bon  Les sentiments exaltés sont bien ceux qui faisaient le succès des ouvrages pour adolescents naguère: amitié, aventure, bravoure, honneur, et on n'ira pas au-delà, les personnages en accord avec le style: monolithiques, uni-dimensionnels. Le conflit interne qui pourrait survenir chez un protagoniste - si l'on a la chance d'y croire - est résolu avec d'autant moins d'ambigüité qu'il aura provoqué ces valeurs éducatives fondamentales.
Les sentiments exaltés sont bien ceux qui faisaient le succès des ouvrages pour adolescents naguère: amitié, aventure, bravoure, honneur, et on n'ira pas au-delà, les personnages en accord avec le style: monolithiques, uni-dimensionnels. Le conflit interne qui pourrait survenir chez un protagoniste - si l'on a la chance d'y croire - est résolu avec d'autant moins d'ambigüité qu'il aura provoqué ces valeurs éducatives fondamentales. 
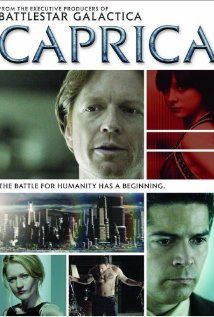 Le dernier monstre des séries télé, c'est bien sûr la version des années 2000 de Battlestar Galactica, une enfilade de 4 saisons et quelques miniséries qui nous jouèrent un space opéra placé dans un univers futuriste riche en références de toutes sortes, avec - pour une fois - une histoire qui se tenait et se développait sans faiblir. Un début, un milieu, une fin, c'est assez rare et méritoire dans ce milieu pour être signalé. Une fois terminée cette saga, difficile de la prolonger quand on en connaît la fin. Pour ne pas laisser perdre le filon, il était par contre possible de s'attaquer à ses origines. Comment était-on arrivé à cet affrontement humains-robots? Eh bien pas de problème, la prequel Caprica s'est aussitôt, une fois la série-mère terminée, proposée de nous en offrir l'explication. Avec les mêmes créateurs et producteurs exécutifs (Ronald Moore, David Eick et Remi Aubuchon) aux commandes, le tournage se fait au Canada et commence par un pilote qui sera poursuivi par des épisodes d'une quarantaine de minutes chacun. La série sera limitée à une saison, arrêtée pour audience insuffisante.
Le dernier monstre des séries télé, c'est bien sûr la version des années 2000 de Battlestar Galactica, une enfilade de 4 saisons et quelques miniséries qui nous jouèrent un space opéra placé dans un univers futuriste riche en références de toutes sortes, avec - pour une fois - une histoire qui se tenait et se développait sans faiblir. Un début, un milieu, une fin, c'est assez rare et méritoire dans ce milieu pour être signalé. Une fois terminée cette saga, difficile de la prolonger quand on en connaît la fin. Pour ne pas laisser perdre le filon, il était par contre possible de s'attaquer à ses origines. Comment était-on arrivé à cet affrontement humains-robots? Eh bien pas de problème, la prequel Caprica s'est aussitôt, une fois la série-mère terminée, proposée de nous en offrir l'explication. Avec les mêmes créateurs et producteurs exécutifs (Ronald Moore, David Eick et Remi Aubuchon) aux commandes, le tournage se fait au Canada et commence par un pilote qui sera poursuivi par des épisodes d'une quarantaine de minutes chacun. La série sera limitée à une saison, arrêtée pour audience insuffisante.  Mais Zoé s'était créée avant sa mort un avatar hyper perfectionné dans un monde virtuel qui, sans connaître tous ses secrets, est une parfaite réplique mentale de son original.
Mais Zoé s'était créée avant sa mort un avatar hyper perfectionné dans un monde virtuel qui, sans connaître tous ses secrets, est une parfaite réplique mentale de son original. 
